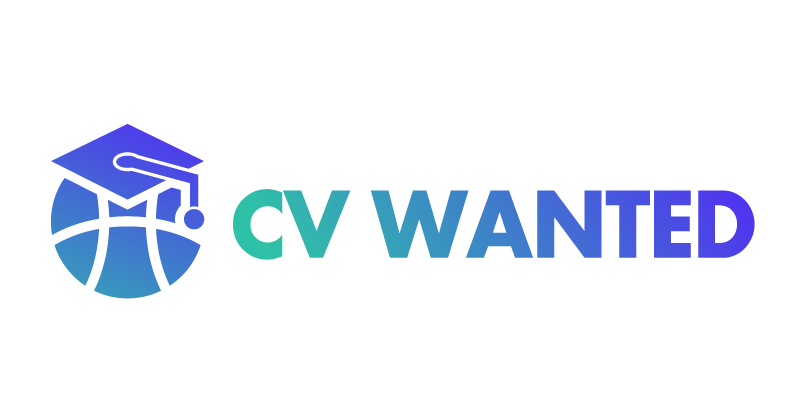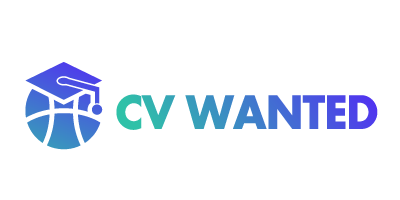Un agent public absent pour raison de santé voit son premier jour d’arrêt maladie retenu sur sa rémunération depuis 2018. Mais la règle n’englobe pas tous les arrêts ni tous les agents, et les exceptions sont loin d’être marginales : accident de service, maladie professionnelle, pathologie lourde, certaines situations échappent à la retenue. Les conditions d’indemnisation ont récemment bougé, faisant évoluer la donne financière pour de nombreux agents. À chaque statut, sa spécificité. Résultat : le casse-tête administratif s’invite dans la gestion des absences au sein des administrations, et chaque cas demande une lecture attentive de la réglementation.
Le jour de carence dans la fonction publique : de quoi s’agit-il vraiment ?
Depuis la loi de finances 2018, la journée de carence s’applique à tout agent public placé en arrêt maladie pour une affection courante. Très concrètement, aucun versement de salaire n’est effectué pour le premier jour d’absence pour raison médicale. On retrouve ici une logique déjà présente dans le secteur privé, où le délai de carence existe depuis longtemps : aligner les pratiques entre agents publics et salariés du privé.
L’objectif est limpide : freiner le recours aux arrêts courts grâce à une retenue systématique. La carence dans la fonction publique concerne autant les fonctionnaires titulaires que les agents contractuels lorsqu’il s’agit d’un premier arrêt maladie sur une période donnée. Attention, chaque nouvel arrêt de travail non consécutif relance le compteur.
L’INSEE publie chaque année des chiffres sur l’absentéisme dans la sphère publique, ce qui permet de mesurer l’effet de ce dispositif sur l’organisation des équipes. Même si la protection sociale des agents publics reste solide sur bien des aspects, cette retenue salariale modifie l’équilibre instauré par la législation.
Précision d’importance : la journée de carence n’a aucune incidence sur les congés pour maladie professionnelle, accident de service ou maternité. Elle ne vise que les arrêts maladie ordinaires, et uniquement sur présentation d’un certificat médical. Ce mécanisme s’inscrit dans un cadre légal mouvant, soumis aux débats des assemblées et aux retouches des lois de finances successives.
Quels agents sont concernés et quelles exceptions existent aujourd’hui ?
La règle s’applique à la grande majorité des agents publics. Qu’ils relèvent de la fonction publique d’État, hospitalière ou territoriale, tous voient cette retenue s’appliquer dès le premier jour d’absence pour maladie ordinaire. Qu’il s’agisse de titulaires, contractuels ou stagiaires, l’ensemble du personnel public entre dans le champ du dispositif.
Mais certaines situations échappent à cette retenue. Voici les cas d’exonération prévus par la réglementation :
- Maladie ordinaire : la carence s’applique
- Accident du travail ou maladie professionnelle : pas de retenue
- Affection de longue durée (ALD) : exonération si un justificatif est présenté
- Maternité, paternité, adoption : exonération assurée
Ces exceptions s’appuient sur la nécessité de protéger les agents confrontés à des pathologies sévères ou à des risques particuliers liés à leur activité. Dans ces cas, il faut obtenir la validation de l’administration, généralement sur avis médical, pour bénéficier de l’exonération.
En pratique, chaque situation peut être différente selon le motif de l’absence. Les collectivités territoriales et les hôpitaux adaptent la gestion des demandes en respectant le cadre légal, parfois avec le soutien de la protection sociale complémentaire qui, selon les contrats choisis par les agents, peut compenser la perte de revenu liée à la retenue.
Comprendre les conséquences concrètes sur la rémunération et les droits des fonctionnaires
Le dispositif de journée de carence modifie l’équilibre salarial dès le premier arrêt maladie constaté. Après remise du certificat médical, la retenue s’effectue sur le traitement indiciaire du fonctionnaire. Résultat immédiat : le salaire correspondant au premier jour d’absence pour maladie ordinaire n’est pas versé. Cette retenue correspond à un trentième du traitement mensuel, et elle s’étend aux accessoires de rémunération tels que le supplément familial de traitement ou la NBI (nouvelle bonification indiciaire).
Ensuite, les jours suivants de l’arrêt sont indemnisés selon les règles en vigueur, à condition de respecter les démarches administratives. Pour beaucoup, cette mesure souligne la différence avec le secteur privé, où le délai de carence peut durer trois jours mais où l’employeur compense parfois une partie du revenu manquant.
Cette retenue sur salaire soulève régulièrement des questions sur la couverture sociale des agents publics. Les droits à la promotion interne, à l’avancement de carrière ou à la retraite ne sont pas affectés directement par la journée de carence, d’après la réglementation actuelle. Mais l’impact sur le budget personnel se fait sentir, en particulier en cas d’arrêts répétés. Les services des ressources humaines rappellent fréquemment ces modalités, notamment dans les hôpitaux et les collectivités, pour accompagner les agents dans la gestion de leur dossier.
Ce que changent les dernières évolutions législatives en matière d’indemnisation
La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 a introduit la journée de carence dans la fonction publique, modifiant durablement le paysage social. Depuis, le cadre n’a cessé d’être précisé. La loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 redéfinit l’indemnisation prévue lors du premier arrêt maladie pour les agents publics. Le texte cherche à rapprocher la règle de celle du privé, tout en s’ajustant aux réalités du service public.
Le projet de loi de finances 2025 annonce de nouveaux ajustements. Objectif : clarifier les cas d’exemption, comme les arrêts pour maladie professionnelle ou accident de service, et renforcer le plafonnement de l’indemnisation pour limiter les dépenses publiques. Avec la loi n°2023-567 du 7 juillet 2023, les employeurs publics doivent désormais informer de façon transparente les agents sur les droits et obligations liés aux absences pour raison de santé.
L’application concrète de ces textes dépend de la publication des décrets. Sur le terrain, certains agents constatent déjà des ajustements dans la gestion des congés maladie, tandis que les services RH adaptent leurs outils de suivi. La transformation de la fonction publique s’écrit au fil des réformes, chaque évolution venant affiner la protection sociale des agents et redéfinir les contours de leur quotidien professionnel.
Reste que pour chaque agent public, derrière la règle, il y a la réalité d’un métier, d’une vie, d’un équilibre parfois fragile. Et à l’heure où la fonction publique évolue, la journée de carence continue de faire débat, sur le terrain comme dans les couloirs du pouvoir.